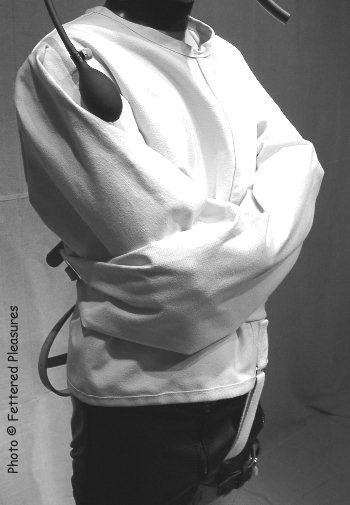Sur les murs défraichis de la salle 36 du Casablancasylum sont diposés les trois toiles fondatrices de la philosophie tordue de notre établissement de soin.
Le Jardin des Délices, de Jérome Bosch.
Le Moine à la Mer, de Caspar David Friedrich.
Et pour finir, La Grande Vague, de Katsushika Hokusaï.
Trois thématiques : folie chez Bosch, solitude chez Friedrich, et impermancence du côté d'Hokusaï.
Arrêtons nous aujourd'hui sur l'écumante estampe marine du maître japonais.
Première gravure de la série : Trente-six vues du mont Fuji, La Vague est un hymne au mouvement, à la toute puissance des éléments, aux flux, reflux des grandes houles et à l'impuissance de l'homme, chahuté, fétus de paille offert comme en offrande aux machoires bleues et blanches du grand océan.
Dans la partie supérieure de la composition, le ciel, symbole du yin, des forces lumineuses, calmes et célestes ; dans la partie inférieure, le yang, ses forces brutales, obscures et terrestres. L'homme au centre de ce maelström tente de conjurer le désastre à venir : la crête de cette lame gigantesque sur le point de fracasser la fureur de son écume sur la frêle embarquation. Dans le fond du tableau, le mont Fuji, immuable témoin de la scène, se rie des turpitudes des marins.
On notera aussi que dans la pensée taoïste, la montagne est un symbole masculin alors que l'eau est en relation avec la féminité : le yin et le yang, les deux aspects complémentaires du monde apparaissent comme les notions fondatrices de cette esthétique qui véhicule aussi une philosophie. La découverte d'une pensée, fondée non sur la séparation de la matière et du divin comme en occident mais au contraire sur leur fusion, constitue sans nul doute le point central de La Vague.
Oeuvre stigmatisant l'impuissance originelle des hommes mais aussi le vide (en particulier dans les parties blanches de la toile, parties non peintes, juste la toile nue, vide). Vide qui, dans la philosophie bouddhiste n'est pas censé représenter une lacune, une béance ou un manque, mais au contraire une notion positive, une sorte de respiration indispensable à la vue et à l'intellect que l'on retrouve aussi bien dans l'architecture que dans la peinture ou les estampes. Ainsi, le blanc du papier apparaît comme une réserve dans l'œuvre d'Hokusai, en souvenir de la feuille immaculée, dans des zones qui représentent tantôt l'écume, tantôt la neige, jouant des similitudes et des jeux de miroir entre ces deux matières issues de l'eau. Dans l'encre de Shitao, le blanc est aussi souvenir du principe de complémentarité entre yin et yang, plein et vide, noir et blanc, montagne et eau, masculin et féminin, toutes les figures de cette complémentarité qui constitue l'essence même de la pensée taoïste et l'origine du monde et de toute création selon cette philosophie.